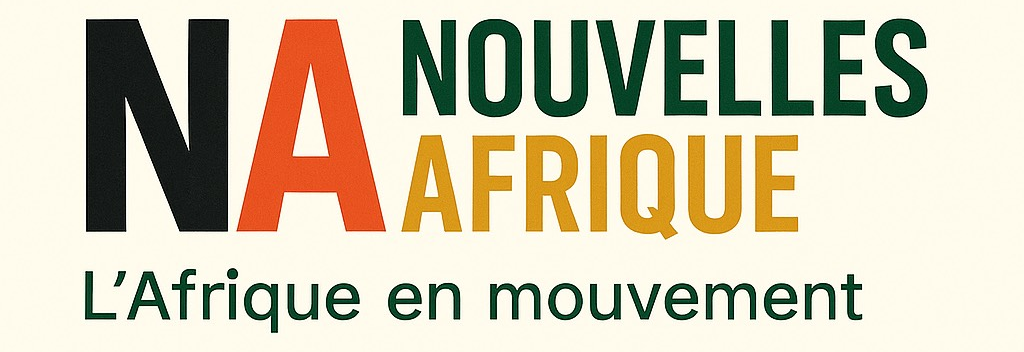LA PERFIDIE DE LA PRESSE FRANÇAISE : UN OUTIL DE DOMINATION NÉOCOLONIALE EN AFRIQUE
La presse française, longtemps perçue comme un bastion de la liberté d’expression, a souvent joué un rôle bien moins noble lorsqu’il s’agit de l’Afrique. Derrière un vernis de neutralité et d’objectivité, elle s’est imposée comme un outil stratégique au service de la politique néocoloniale française. En orientant les récits, en amplifiant certaines voix et en en réduisant d’autres au silence, elle contribue à maintenir l’Afrique sous le joug d’une domination insidieuse.
La presse française a souvent été accusée d’être un prolongement des intérêts économiques et géopolitiques de l’État français. Selon le journaliste et essayiste François-Xavier Verschave, auteur de « La Françafrique : Le plus long scandale de la République », « les médias français participent à la construction d’un récit qui légitime la prédation économique et les interventions militaires en Afrique ». Ce récit est soigneusement élaboré pour justifier la présence française sur le continent sous couvert de « stabilisation » ou de « lutte contre le terrorisme ».
Prenons l’exemple du Mali. Lorsque ce pays a décidé de rompre avec le partenariat militaire français en 2022, la presse française s’est empressée de dénigrer ses nouvelles autorités, les qualifiant de « junte », un terme rarement utilisé pour des régimes alliés de la France, même autoritaires. Le Monde publiait ainsi un article intitulé « Le Mali, une dictature en devenir », qui s’alignait sur le discours officiel de Paris, visant à discréditer les choix souverains du peuple malien.
La presse française excelle dans l’art de créer des « ennemis publics » africains pour justifier les ingérences extérieures. En Côte d’Ivoire, Laurent Gbagbo, pourtant élu démocratiquement en 2010, a été systématiquement présenté comme un tyran refusant de quitter le pouvoir, tandis qu’Alassane Ouattara, soutenu par la France, bénéficiait d’une couverture médiatique favorable. Robert Bourgi, ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, l’a reconnu dans son livre « Ils savent que je sais tout » : « Toute la stratégie pour installer Ouattara passait aussi par la manipulation de l’opinion publique, notamment à travers des médias comme France 24 et RFI. »
De manière similaire, le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso ou Assimi Goïta au Mali sont régulièrement diabolisés dans les médias français. À chaque fois, le schéma est le même : présenter ces leaders comme des dangers pour la stabilité régionale, tout en occultant les raisons profondes de leurs décisions, notamment le rejet de la tutelle française.
Lorsque la France est directement impliquée dans des scandales en Afrique, la presse française adopte un silence pesant. Par exemple, l’opération Persil en Guinée, où la France a inondé le pays de faux billets pour déstabiliser Sékou Touré, est rarement évoquée. Maurice Robert, ancien chef des services secrets français en Afrique, confie dans ses mémoires : « Tout était orchestré pour affaiblir économiquement la Guinée et contraindre son président à revenir sous l’aile protectrice de la France. » Pourtant, cette sombre page de l’histoire est largement absente des colonnes des grands médias français.
La presse française a également contribué à légitimer des interventions armées en Afrique, souvent sous prétexte de restaurer la démocratie ou de combattre le terrorisme. En Libye, par exemple, elle a relayé sans critique les arguments de l’OTAN pour justifier l’intervention militaire de 2011. Pourtant, cette intervention a plongé la Libye et toute la région du Sahel dans un chaos dont les populations continuent de souffrir. Le journal Libération publiait à l’époque : « Kadhafi, le fou sanguinaire qui doit être arrêté », sans jamais questionner les motivations réelles de l’intervention ni les conséquences désastreuses pour l’Afrique.
Lorsqu’un pays ou un leader africain tente de s’émanciper de la tutelle française, la presse française joue son rôle de garde-chiourme. En 2023, après le coup d’État au Niger, des médias comme France 24 et RFI ont relayé en boucle des discours alarmistes sur les risques d’instabilité, tout en appelant à une intervention militaire de la CEDEAO, perçue comme un bras armé de la France.
En revanche, peu de reportages ont donné la parole aux populations locales, qui manifestaient massivement en soutien aux nouvelles autorités et pour dénoncer l’ingérence française. Ce déséquilibre flagrant dans la couverture médiatique révèle une volonté de modeler l’opinion publique internationale selon les intérêts de Paris.
La presse française, loin d’être neutre, est un outil actif de la politique néocoloniale. En façonnant les récits, en sélectionnant les voix qu’elle amplifie et en occultant celles qui dérangent, elle participe au maintien d’un système inique. Comme le disait le journaliste béninois Francis Kpatindé : « L’Afrique ne sera libre que lorsque le récit africain dominera le récit occidental. »
Il est temps pour l’Afrique de s’approprier ses narratifs, de dénoncer la perfidie des récits biaisés, et de promouvoir une presse souveraine, au service de ses peuples et de ses vérités.