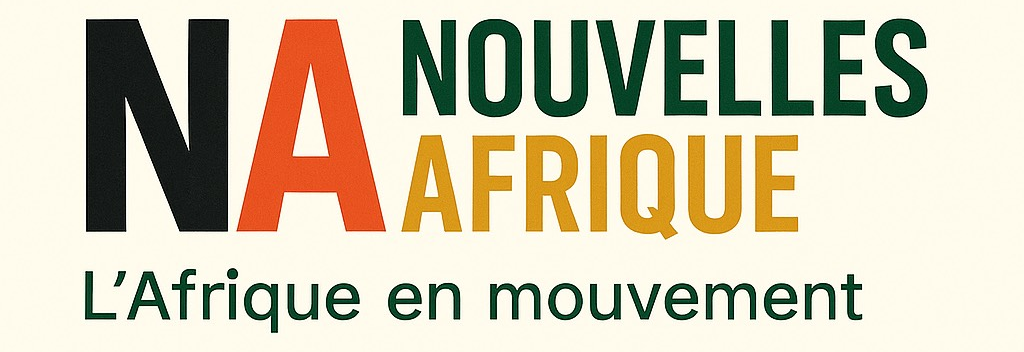Le spectre de la Fédération brisée
Au moment où le soleil s’éteint derrière l’horizon, l’Afrique demeure en éveil, secouée par la promesse d’un renouveau. Dans les rues de Bamako, de Ouagadougou ou de Niamey, une flamme nouvelle s’élève : celle de l’Alliance des États du Sahel (AES). Mais à peine ce souffle de liberté se propage-t-il que l’on sent déjà l’étreinte de forces tapies, prêtes à envenimer la situation. Beaucoup y voient un écho glaçant des tragédies passées, car il fut un temps où la Fédération du Mali avait suscité la même ferveur.
En 1959, lorsque le Soudan français (aujourd’hui le Mali) et le Sénégal s’unirent sous une même bannière, on crut enfin tenir la clé pour abattre les barrières tracées par la colonisation. Sur les places publiques, au son des tam-tams, la joie éclatait : l’Afrique pouvait désormais écrire son histoire sans entraves. Léopold Sédar Senghor, Modibo Keïta et d’autres leaders élevaient la voix pour défendre une indépendance totale, loin des pressions occidentales. Mais dans l’ombre, Félix Houphouët-Boigny, soutenu par des réseaux désireux de maintenir la mainmise sur la région, fomentait un plan pour briser cette union. Par le jeu des rivalités et des menaces, la Fédération fut sapée, et ses idéaux sombrèrent avant même d’avoir pu porter leurs fruits. On se souvient des mots de Frantz Fanon, dans Les Damnés de la Terre : « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. » En cette sombre année 1960, la mission d’unité fut trahie.
Les décennies suivantes virent défiler d’autres figures porteuses de grands espoirs. Patrice Lumumba, assassiné en 1961, symbolisait la soif de liberté des peuples ; Kwame Nkrumah, renversé en 1966, avait rêvé d’un panafricanisme audacieux ; Thomas Sankara, éliminé en 1987, avait osé clamer : « Malheur à ceux qui bâillonnent le peuple. » À chaque époque, les mêmes forces s’activaient pour étouffer toute volonté d’émancipation. Des chefs d’État fragilisés, la pression de l’ancienne métropole, la peur brandie comme une arme : le scénario semblait écrit à l’avance. Des accords se négociaient en secret, et l’Afrique, maintes fois, se retrouvait à genoux.
Aujourd’hui, beaucoup se tournent avec méfiance vers Alassane Dramane Ouattara, qui paraît rejouer la partition jadis déployée contre la Fédération du Mali. Des rumeurs font état de rencontres discrètes, de pactes conclus à l’abri des regards pour miner l’AES. De l’autre côté, la France, consciente qu’une confédération puissante renverserait l’échiquier de la dépendance, veille à préserver ses intérêts. Dès la Conférence de Brazzaville, en 1944, Charles de Gaulle insistait déjà sur la nécessité de garder l’Afrique dans le giron français. Pour concrétiser cette ambition, on a gravé dans le marbre des frontières arbitraires et concocté des traités léonins.
Pourtant, les choses ont changé. Dans les universités de Bamako, d’Abidjan ou de Niamey, des jeunes débattent sans relâche, passés en mémoire les récits tragiques de la Fédération du Mali et la chute de figures emblématiques comme Sankara ou Lumumba. Les réseaux sociaux relaient des informations qu’on ne peut plus étouffer aussi facilement. Les slogans résonnent de Bouaké à Gao : « Notre unité est notre force, notre liberté est notre droit. » Partout, on comprend que le seul moyen de déjouer les vieux chantages, c’est de se rassembler.
L’Alliance des États du Sahel n’est plus un simple dossier diplomatique : elle est la flamme d’une génération qui ne veut plus se résigner à l’injustice, qui aspire à rompre la spirale des compromissions et des divisions. Le peuple gronde, et les fantômes d’hier peinent à étouffer ce souffle de courage. Dans les ruelles de Dakar et dans celles de Bamako, on se chuchote les mots de Thomas Sankara : « Oser inventer l’avenir. » Ces mots, d’abord murmurés, prennent aujourd’hui la force d’un cri.
La nuit s’achève, et l’aube éclaire un continent en effervescence. Les stratagèmes fomentés pour faire chanceler l’unité sont bien réels, mais plus personne n’est disposé à courber l’échine. La lutte sera rude, car il est toujours plus aisé de manœuvrer là où règnent la peur et la désunion. Pourtant, un frisson parcourt les esprits : cette fois, l’Afrique est prête à se dresser contre les tractations secrètes et les chantages voilés. Les mêmes mains qui ont jadis tiré les ficelles peuvent bien s’agiter, elles ne viendront plus à bout d’une volonté qui s’est forgée dans les larmes et le sang.
« Cette fois, l’Afrique ne reculera plus », susurrent des voix dans l’obscurité, comme un serment que nul ne pourra briser. Et dans ces mots, qui s’échangent de village en village, de foyer en foyer, brûle la certitude que plus rien ne sera comme avant. L’Alliance des États du Sahel pourrait bien devenir ce pont qui unit tous ces rêves épars, où chaque peuple retrouve sa dignité, et où l’histoire, enfin, cesse de se répéter.