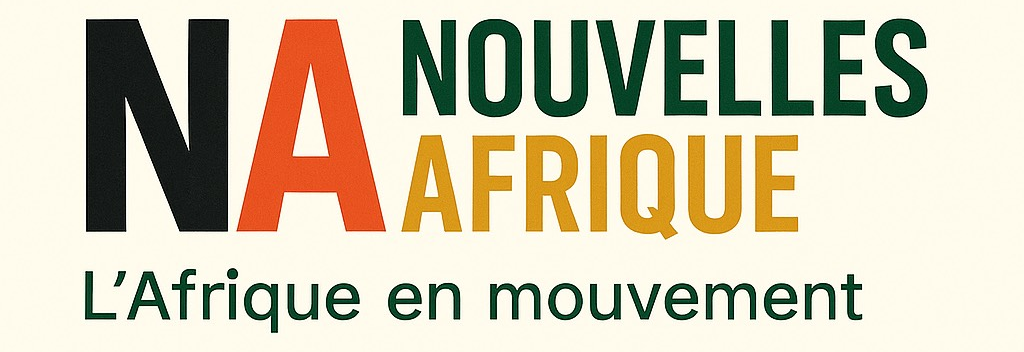France: La rue contre l’État : quand le pouvoir d’Emmanuel Macron atteint ses limites
Depuis plusieurs semaines, la France est traversée par une série de mobilisations sociales inédites dans leur ampleur et leur intensité. Enseignants, cheminots, soignants, étudiants, usagers, salariés du public comme du privé, chacun dans leurs secteurs mais avec des convergences, se sont donnés rendez-vous dans la rue, dans les gares, dans les écoles, pour dire leur exaspération. Ces mobilisations ne sont pas de simples épisodes de contestation : elles trahissent un point de rupture pour le pouvoir d’Emmanuel Macron.
Un pouvoir confronté à l’usure
Le président est arrivé à l’Élysée avec l’ambition de renouveler l’action publique, de réformer l’État et de dépasser le clivage gauche/droite. Mais aujourd’hui, la révolte dans la rue suggère que ce pari s’érode. Plutôt qu’un sursaut réformiste, l’exécutif paraît devenu l’objet principal de la colère. Le fiasco du précédent Premier ministre sur le plan budgétaire, la succession rapide des gouvernements et la fragilité de sa coalition ont creusé une défiance durable.
Rapports d’ONG, observations de juristes et critiques d’associations pointent un « décrochage démocratique » : obstacles au droit de manifester, usage contesté des forces de l’ordre, communication étatique de plus en plus verticale.
Dans ce contexte, le mouvement « Bloquons tout » est révélateur. Le 10 septembre, des actions de blocage se sont multipliées sur le territoire : axes routiers, gares, transports urbains, quartiers entiers. Puis, le 18 septembre, les syndicats ont appelé à une grande journée de grève et de manifestations. Selon les chiffres officiels, environ 275 000 personnes étaient présentes, tandis que les syndicats évoquent jusqu’à 400 000. Les secteurs essentiels ont été touchés : hôpitaux, écoles, transports publics.
Ces mobilisations massives portent une triple signification :
Elles illustrent la saturation du gouvernable. La population ne demande plus seulement des ajustements : elle exige une redéfinition du modèle social, des repères plus favorables aux services publics, à la redistribution.
Elles dessinent l’effondrement de la légitimité d’un État-action fort. Celui qui impose depuis le sommet ne convainc plus.
Elles donnent la parole à des couches sociales qui jusque-là étaient en retrait. La jeunesse, les classes moyennes précarisées, les soignants et les personnels éducatifs prennent la scène.
Le seuil de compétence : ce que cela signifie
Par « seuil de compétence », on entend que l’exercice du pouvoir est arrivé à ses limites : l’appareil d’État est toujours présent, les lois peuvent encore être votées, mais le gouvernement ne parvient plus à convertir ses intentions en acceptation collective. Voici quelques marqueurs :
Perte de maîtrise politique. Le pouvoir ne pilote plus les agendas, il réagit aux crises.
Crise de l’autorité morale. La figure présidentielle ne galvanise plus : elle concentre la frustration.
Risque institutionnel croissant. Les résolutions d’assemblée, les institutions intermédiaires, les corps sociaux sont méprisés ou contournés. Le pouvoir paraît s’en remettre de plus en plus à l’exception : usage intensif des pouvoirs exécutifs, communications sécuritaires, gestion de l’urgence.
Démobilisation centripète. Les partis et groupes traditionnellement relais de l’opposition peinent à canaliser la colère, laissant la rue comme principal lieu d’expression politique.
À ce stade, l’État n’est plus seulement contesté sur tel ou tel projet : il est mis en cause dans son mode même d’être.
Pourquoi aucune voie intuitive ne paraît possible
Alors, pourquoi le pouvoir n’arrive-t-il pas à sortir de l’ornière ?
Le piège de l’austérité dans un contexte de dette. Le gouvernement est tenu par des contraintes économiques et financières qui limitent sa marge de manœuvre.
La multiplication des fractures. Territorialement, socialement, culturellement, les déséquilibres se creusent. L’Élysée peine à parler d’un seul langage.
La raréfaction de l’espace démocratique intermédiaire. Les syndicats, les associations, les collectivités régionales sont mis sous tension ou marginalisés, réduisant la capacité d’intermédiation.
L’illusion de la technologie et de la méthode. L’exécutif pensait remodeler la relation à la citoyenneté via les outils numériques et un pilotage centralisé. Mais le rapport de force social a rattrapé cette approche.
En conclusion : vers une bifurcation imposée ?
Ce que révèlent les mobilisations récentes, ce n’est pas simplement le rejet d’une politique : c’est la remise en cause d’un modèle de l’exercice du pouvoir. Emmanuel Macron se trouve aujourd’hui face à une équation impossible à résoudre en l’état : maintenir l’État fort sans rescinder le lien avec les citoyens, mener des réformes structurelles sans les subir, gouverner un pays fracturé sans redonner des fondements de confiance.
Le seuil de compétence n’est pas encore définitif. Rien n’interdit un redressement. Mais il est franchi dans les esprits. À moins que le pouvoir n’accepte de revisiter ses fondamentaux, l’issue pourrait bien être une bifurcation dont l’arène ne sera plus le Parlement, mais la rue.