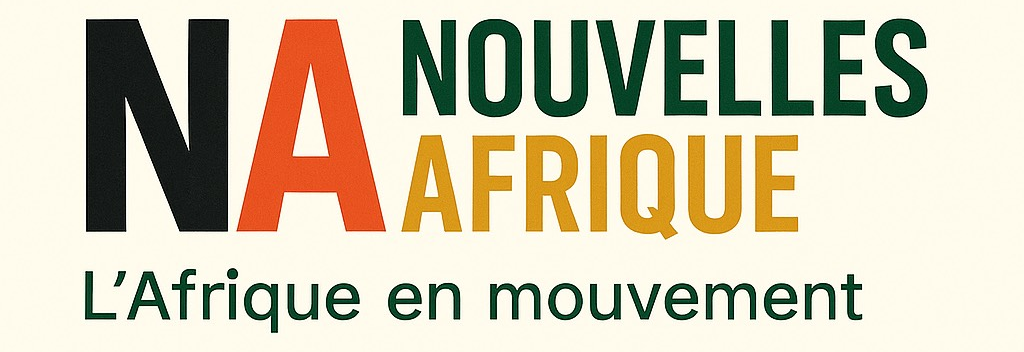Presse / Monde politique: Je t’aime, moi non plus !
Dans son adresse à ses compatriotes, le lundi 6 octobre dernier, le président du Faso, Ibrahim Traoré, est revenu sur le rôle éminemment stratégique et central de la presse dans nos États, tout en insistant sur la nécessité pour elle d’œuvrer toujours dans l’intérêt du pays et des masses populaires, par un travail d’explication et de veille citoyenne, surtout en ces temps de crise impérialiste imposée au Burkina Faso, que celui-ci affronte avec vaillance et détermination.
Cela nous ramène aux relations tumultueuses entre monde politique et monde médiatique depuis le « printemps démocratique africain » décrété par François Mitterrand, qui avait réuni bon nombre de chefs d’État africains à La Baule pour leur délivrer un cours magistral sur la démocratie gréco-romaine et sur la nécessité pour eux de s’y conformer désormais, en « ouvrant le jeu politique » aux opposants par le biais d’élections législatives et présidentielles tenues à date régulière. Une ouverture plus grande donc, de la part de l’État, pour l’édification d’une société démocratique, laquelle requiert l’existence d’un espace politique fort ainsi que de forces politiques libres et autonomes, capables de s’exprimer sans être exposées à des représailles ou à des ingérences dans leurs affaires internes.
Rome à Bamako, Niamey, Ouagadougou ou Dakar… Admettez qu’à défaut de faire désordre, ce « mot d’ordre » avait peu de chances de prospérer, comme l’avenir le démontrera à travers l’institution de satrapies et de « monarchies » constitutionnelles, sur fond de ploutocratie. Mais là n’est pas notre propos. Pour y revenir, disons que, pour parvenir à cette société démocratique, il était nécessaire de promouvoir une presse indépendante, forte et professionnelle.
Au lieu d’approfondir cette action, nous sommes plutôt entrés dans une période d’incertitudes et de flou, traduite par des guéguerres entre monde politique et monde médiatique, où la presse dénonçait des tentatives de « caporalisation » (sic). Avec l’argent roi qui circulait entre les deux, surtout en période électorale, certains journalistes sont devenus des mercenaires qui voyaient midi uniquement à leur porte… ou à celle de leurs mentors.
Or, ce que la plupart de ces journalistes semblaient oublier, c’est que nous sommes tous sur la même branche : si elle se casse, il n’y aura ni démocratie, ni activité médiatique. C’est ce que rappelait le chef de l’État dans son adresse.
Il est donc clair qu’il existe des sujets tabous, comme partout ailleurs dans le monde. Le traitement du conflit récent entre Israël et l’Iran l’a révélé : les journalistes des deux côtés se sont gardés de faire état des pertes enregistrées par leurs armées, tout en fouettant l’orgueil et le patriotisme de leurs compatriotes. En temps de crise, le pays a besoin d’un gouvernement fort et non empêtré dans des conflits d’intérêts. D’où la nécessité d’assurer cette souveraineté médiatique.
La guerre, disait-on, est un acte de violence destiné à contraindre l’ennemi à exécuter notre volonté. Nous devons tous y concourir. Les médias doivent entraîner un mouvement de mobilisation générale, fouetter le patriotisme des combattants et être leur héraut, en tout temps et en tout lieu. Telle est la responsabilité de chacun, pour ramener la paix et la quiétude à nos braves populations, et poursuivre plus avant les chantiers de développement déjà engagés malgré les vicissitudes de l’heure.
En tout état de cause, l’ordre et la discipline prévaudront.