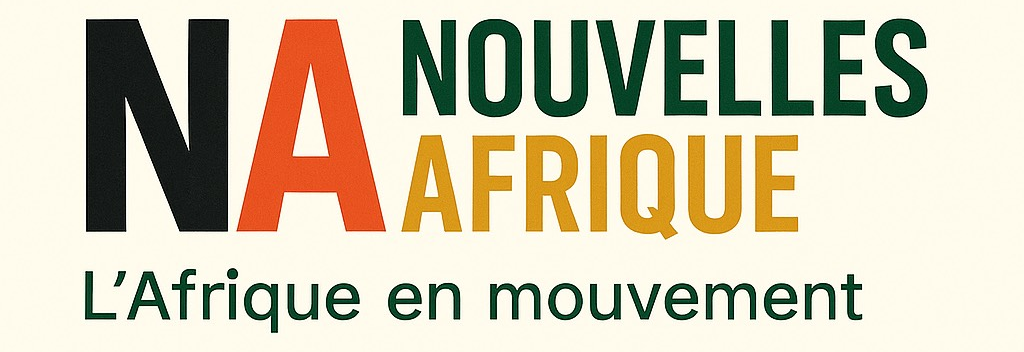La CPI, une justice à géométrie variable
Depuis sa création, la Cour pénale internationale (CPI) se présente comme l’ultime garant d’une justice universelle capable de sanctionner les crimes les plus graves. Mais derrière ce discours officiel se cache une pratique marquée par des choix sélectifs, des décisions à double standard et une orientation qui sert souvent davantage les intérêts des puissances dominantes que ceux de la justice impartiale. Les exemples sont multiples et parlent d’eux-mêmes.
Dix ans volés à Laurent Gbagbo
L’exemple le plus frappant reste celui de la Côte d’Ivoire. Laurent Gbagbo, ancien président, a été transféré à La Haye et privé de sa liberté pendant près de dix ans. Dix années derrière les barreaux, avant que la CPI n’admette son innocence en 2019. Mais ce qui choque le plus, c’est l’absence totale de poursuites contre les acteurs du camp adverse. Or, dans une guerre civile où deux forces s’affrontent, blanchir un camp revient logiquement à désigner l’autre comme responsable. La CPI, en choisissant de ne jamais émettre le moindre mandat d’arrêt contre les proches d’Alassane Ouattara, a validé une justice asymétrique, donnant le sentiment d’un tribunal taillé sur mesure.
Des mandats tournés vers l’Afrique
La tendance ne s’arrête pas au seul cas ivoirien. Depuis vingt ans, la quasi-totalité des mandats d’arrêt de la CPI visent des responsables africains : Omar el-Béchir au Soudan, Uhuru Kenyatta au Kenya, Thomas Lubanga ou Bosco Ntaganda en République démocratique du Congo. Pendant ce temps, aucun responsable occidental n’a jamais été inquiété, malgré des interventions militaires contestées qui ont laissé derrière elles des dizaines de milliers de victimes civiles. La CPI ferme les yeux lorsqu’il s’agit de crimes commis par les grandes puissances, mais agit avec célérité quand il s’agit de dirigeants africains ou de pays sans poids géopolitique. Une justice qui prétend être universelle ne peut s’accommoder de pareils angles morts.
Quand la Cour perd sa crédibilité
Ce déséquilibre systématique a fini par entamer toute crédibilité. En Afrique, la CPI est de plus en plus perçue non pas comme une institution de justice, mais comme un outil de domination, une sorte de prolongement du vieux système impérial où l’Occident jugeait et condamnait tandis que les autres subissaient. L’ironie est d’autant plus amère que ce sont des pays africains qui, en grand nombre, avaient soutenu la création de la Cour au départ, croyant à un instrument impartial de régulation internationale.
L’AES choisit de rompre les chaîne
C’est dans ce contexte que l’Alliance des États du Sahel (AES), regroupant le Mali, le Burkina Faso et le Niger, a décidé de tourner la page. En annonçant leur retrait de la CPI, ces pays ont dénoncé ce qu’ils considèrent comme une mascarade judiciaire, une « arnaque » destinée à protéger certains et à accabler d’autres. Leur décision ne relève pas d’un caprice diplomatique, mais d’une analyse lucide : pourquoi rester liés à une juridiction qui ne protège pas leurs peuples, mais qui peut à tout moment être utilisée contre eux ?
La voie des justices souveraines
Les faits sont clairs. La CPI n’a jamais poursuivi de manière équilibrée. Elle a multiplié les procédures inéquitables, infligé des détentions prolongées injustifiées comme dans le cas Gbagbo, et épargné systématiquement les puissants. Face à cette réalité, la recherche d’une justice souveraine, enracinée dans les réalités locales et affranchie des pressions impérialistes, apparaît comme une voie non seulement légitime, mais nécessaire. L’Alliance des États du Sahel n’a pas simplement claqué la porte d’une institution ; elle a rappelé au monde que la dignité des peuples ne se négocie pas dans les couloirs de La Haye, surtout lorsque ces couloirs sentent trop fort le parfum des intérêts des plus forts.