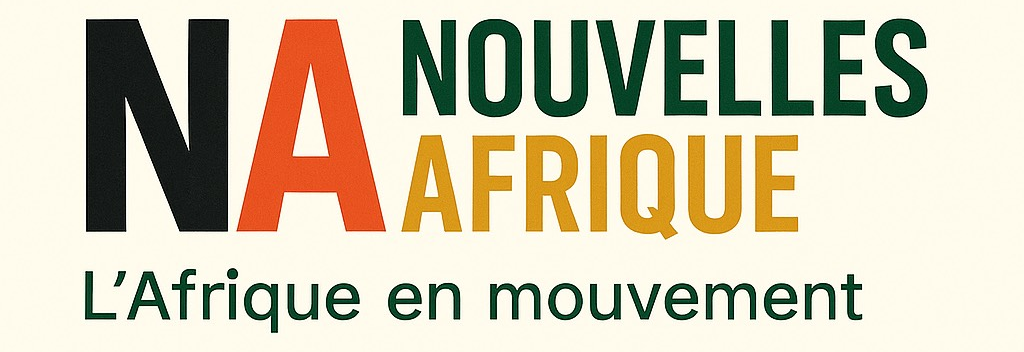La Dérive Autocratique d’Alassane Ouattara : Une Chronique de la Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire, avec ses richesses agricoles et son passé de locomotive économique de l’Afrique de l’Ouest, a longtemps incarné un modèle de stabilité post-indépendance sous Félix Houphouët-Boigny, président de 1960 à 1993. Mais ce vernis de prospérité masquait des tensions ethniques et sociales, exacerbées après sa mort. Depuis 2011, Alassane Ouattara, président en exercice, est au cœur d’une transformation du pays marquée par des controverses sur sa nationalité, des accusations de financement d’une rébellion et une consolidation du pouvoir par la répression et l’instrumentalisation de la justice. Cet article retrace, sur la base de faits documentés, son parcours et ses implications dans les crises ivoiriennes, sans spéculations ni extrapolations.
Une Nationalité Contestée
Alassane Ouattara, né officiellement le 1er janvier 1942 à Dimbokro, en Côte d’Ivoire, a vu sa citoyenneté remise en question dès les années 1990. Ancien haut fonctionnaire du FMI et gouverneur de la Banque centrale des États de l’Afrique de l’Ouest, il devient une figure politique de premier plan au sein du PDCI, le parti d’Houphouët-Boigny. Mais en 1993, après la mort de ce dernier, Henri Konan Bédié, son successeur, promeut l’ivoirité, une politique visant à privilégier les "Ivoiriens de souche" et à marginaliser les populations du Nord et les immigrés. Ouattara, d’ethnie dioula et musulman, est accusé par ses détracteurs d’être né au Burkina Faso, à Sindou, dans une famille de commerçants mossi. Des documents administratifs burkinabè, cités par des médias comme *Jeune Afrique* en 1995, mentionnent un certain Dramane Ouattara, sans lien clair avec Dimbokro. La Constitution de 1960, exigeant une naissance sur le sol ivoirien pour la présidence, sert de prétexte pour l’exclure de la course électorale de 1995. La Cour suprême, sous influence de Bédié, déclare sa candidature irrecevable. Ouattara quitte le PDCI et fonde en 1994 le RDR (Rassemblement des Républicains), un parti fédérant les Nordistes et les exclus de l’ivoirité.
La Rébellion de 2002 et les Accusations de Financement
En décembre 1999, un coup d’État militaire renverse Bédié, et Robert Guéï prend le pouvoir. Ouattara, alors en exil à Paris, est à nouveau exclu des élections de 2000, remportées par Laurent Gbagbo (FPI) dans un climat de violence. Le 19 septembre 2002, une rébellion éclate à Bouaké, menée par des militaires nordistes regroupés sous la bannière des Forces Nouvelles. Ce conflit divise le pays en deux jusqu’en 2007, causant environ 3 000 morts et des centaines de milliers de déplacés, selon les estimations de l’ONU. Des accusations graves pèsent sur Ouattara. Zakaria Koné, un commandant des Forces Nouvelles, déclare publiquement dans une vidéo diffusée en 2004 que Ouattara était le principal financier de la rébellion. Ces propos, relayés par des médias locaux et archivés sur des plateformes en ligne, pointent des flux d’argent provenant de réseaux diasporiques et régionaux, notamment via le Liberia et le Burkina Faso. Un rapport d’International Crisis Group de 2003 évoque des soutiens financiers extérieurs aux rebelles, sans nommer directement Ouattara, mais des câbles diplomatiques américains, révélés par WikiLeaks en 2011, mentionnent des soupçons similaires. Aucune enquête indépendante n’a jamais été menée pour vérifier ces allégations ou établir les responsabilités des exactions commises durant la guerre civile, laissant les victimes sans justice, comme le souligne un rapport d’Amnesty International de 2013.
L’Accession au Pouvoir et les Violences Post-Électorales
Les accords de paix de Marcoussis (2003), sous médiation française, instaurent un gouvernement de coalition. Ouattara revient en Côte d’Ivoire comme Premier ministre, mais les tensions persistent. Les élections, repoussées à plusieurs reprises, ont lieu en 2010. Ouattara obtient 54,1 % des voix selon la Commission électorale indépendante, soutenue par l’ONU, tandis que Gbagbo, appuyé par le Conseil constitutionnel, revendique la victoire. La crise qui s’ensuit dégénère en conflit armé. En mars 2011, les Forces Nouvelles, appuyées par des frappes de l’ONU et de la France, s’emparent d’Abidjan. Gbagbo est arrêté le 11 avril 2011. Les violences post-électorales font environ 3 000 morts, selon l’ONU. Des rapports d’Human Rights Watch (2011) et d’Amnesty International (2012) documentent des exactions commises par les forces pro-Ouattara, notamment à Duékoué, où plus de 700 civils sont tués, et à Yopougon, où des charniers sont découverts. Malgré ces crimes, aucun responsable du camp Ouattara n’a été poursuivi, contrairement à Gbagbo, transféré à la Cour pénale internationale en novembre 2011 pour crimes contre l’humanité.
Une Justice à Deux Vitesses
Ouattara, investi président en mai 2011, promet la réconciliation. Pourtant, la justice devient un outil de répression. En 2015, il est réélu avec 83,7 % des voix dans un scrutin boycotté par une partie de l’opposition. En 2016, des mutineries éclatent à Bouaké, révélant des tensions dans l’armée, financée pour garantir sa loyauté. En 2020, Ouattara annonce un troisième mandat, malgré la limite constitutionnelle de deux, invoquant le décès de son successeur désigné, Amadou Gon Coulibaly. L’opposition, menée par Bédié et d’autres figures, appelle au boycott. La répression est brutale : Human Rights Watch rapporte 56 morts lors des manifestations de novembre 2020. Bédié est placé en résidence surveillée, et plusieurs opposants sont arrêtés pour "troubles à l’ordre public". En 2023, des militants du FPI, dont des avocats, sont emprisonnés pour des publications sur les réseaux sociaux qualifiées d’"incitation à la haine". La Cour africaine des droits de l’homme, dans un arrêt de 2022, condamne la Côte d’Ivoire pour détentions arbitraires et violations des droits à un procès équitable, sans effet sur les pratiques du régime.
Une Nationalité Toujours Controversée
La question de la nationalité d’Ouattara reste irrésolue. En 2016, un décret présidentiel tente de clarifier son statut, mais des enquêtes indépendantes, notamment publiées par *Le Monde Afrique* en 2021, révèlent l’absence de traces fiables de sa naissance à Dimbokro avant 1995. Cette ambiguïté continue de nourrir les tensions dans un pays fracturé par l’ivoirité. Sous Ouattara, l’économie croît à 7 % par an, portée par les infrastructures et le cacao, mais la liberté d’expression recule. En 2022, le journal *Notre Voie* est suspendu pour avoir critiqué la gestion des finances publiques. Les élections locales de 2023, boycottées par l’opposition, renforcent la domination du RDR.
Une Impunité Enracinée
La Côte d’Ivoire d’aujourd’hui brille par ses gratte-ciel, mais ses fondations démocratiques s’effritent. Ouattara, à 83 ans, dirige un pays où les accusations de financement de la rébellion de 2002, corroborées par des déclarations comme celle de Zakaria Koné, n’ont jamais fait l’objet d’une investigation sérieuse. Les crimes de la guerre civile et de la crise de 2010-2011 restent impunis pour son camp, tandis que ses adversaires sont ciblés par une justice sélective. Les rapports d’ONG, dont celui de la FIDH en 2021, appellent à une commission vérité et réconciliation indépendante, sans réponse du pouvoir. La société civile, muselée, murmure son mécontentement, mais le palais présidentiel reste sourd.